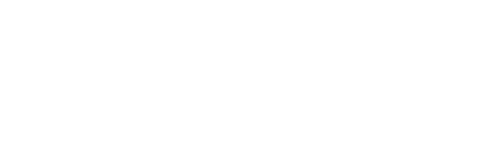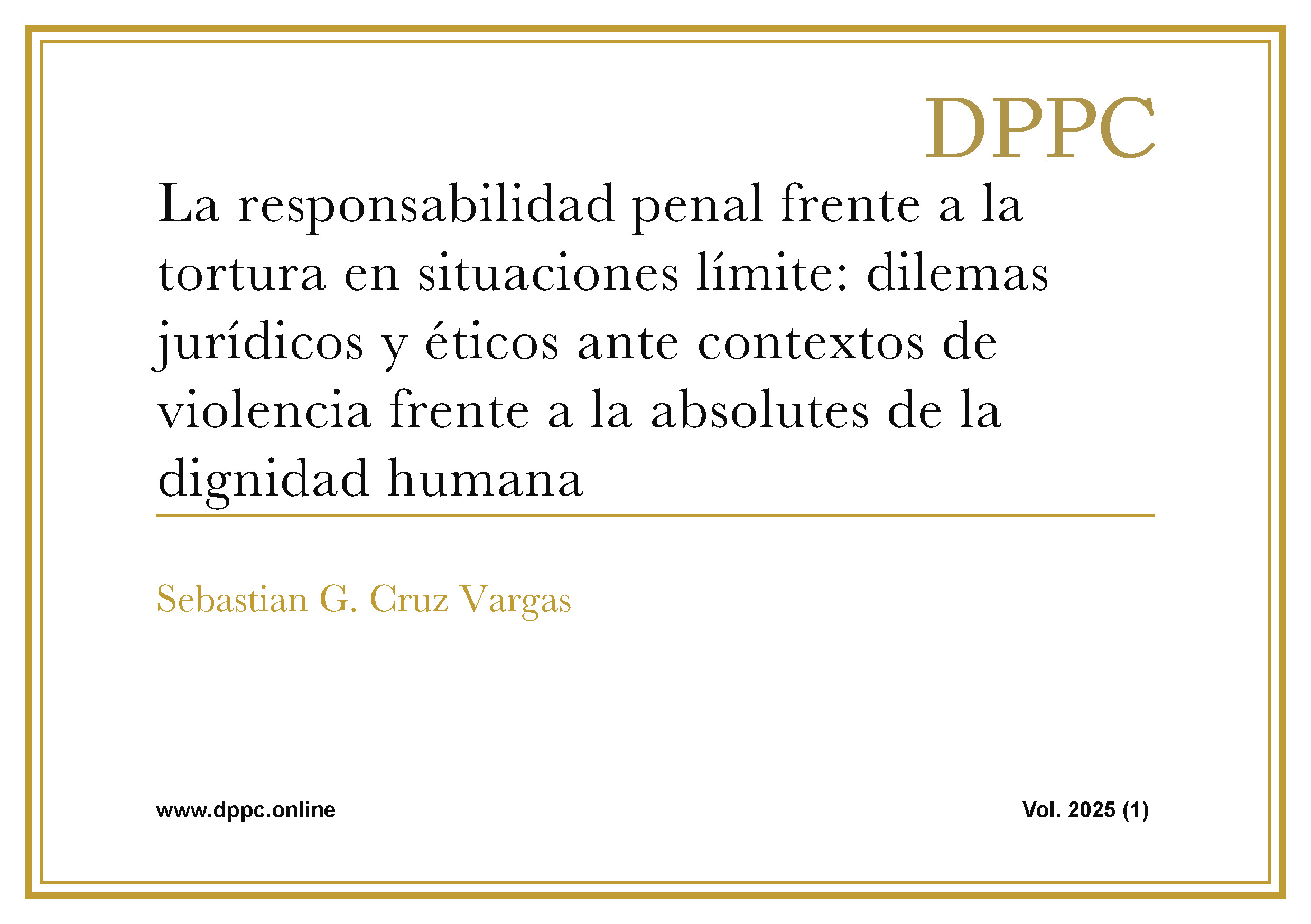Résumé
L’article analyse les dilemmes juridiques et éthiques auxquels le droit pénal est confronté dans des situations dites limites, en examinant la responsabilité pénale du tortionnaire lorsque la torture est envisagée comme l’unique alternative pour éviter un dommage imminent à des biens juridiques fondamentaux. L’étude s’ouvre par une analyse des situations limites dans les contextes de terrorisme et d’insécurité au Pérou, où la torture apparaît comme un recours fréquent mais disproportionné. Cette réflexion est illustrée par des atteintes à la vie, à l’intégrité physique et à d’autres biens essentiels, à travers l’examen de cas emblématiques tels que l’hypothèse de la “bombe à retardement” et l’affaire Gäfgen c. Allemagne. Un examen technico-juridique est ensuite mené sur les causes de justification (illicéité) et d’excuse (culpabilité), en précisant leurs limites normatives à la lumière du droit international et du droit péruvien, afin de mieux circonscrire leur portée en matière de torture. Enfin, le travail poursuit son objectif principal: éclairer la complexité de la qualification pénale de ces actes extrêmes dans des contextes limites, au moyen d’une réflexion critique sur le recours à la torture comme unique moyen dans une situation critique, et ce, au regard de la cohérence éthique et de la suffisance juridique du système pénal péruvien face à de tels cas exceptionnels.