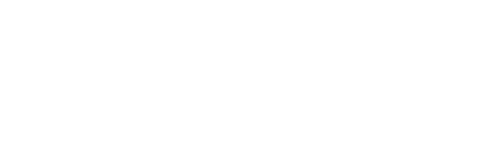Entrevue avec José Luis González Cussac, Professeur ordinaire de droit pénal et Directeur de la Chaire « Études sur le terrorisme et droits des victimes » (Université de Valence)
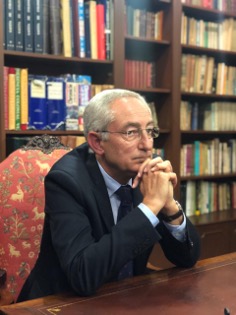
Le rôle des services de renseignement espagnols dans la lutte contre le terrorisme
(traduction de l'entretien réalisé en espagnol)
Dans votre chapitre « Servicios de inteligencia y contraterrorismo » (González Cussac, 2018, p. 35-39), vous décrivez les services de renseignement comme un acteur indispensable dans la lutte contre le terrorisme. Comment définiriez-vous aujourd’hui le rôle exact des services de renseignement espagnols au sein du système national de sécurité face au terrorisme international ? Quelles lois et normes régissent leur action ?
Je pense que l’activité de contre-terrorisme menée par le Centre national de renseignement (CNI) demeure essentielle pour anticiper et prévenir des actions terroristes. Cela reste sans aucun doute l’une de ses priorités. La création en 2014 du Centre de renseignement contre le terrorisme et la criminalité organisée (CITCO), où le CNI est intégré aux côtés des autres forces de police spécialisées en matière antiterroriste et d’autres organismes, a représenté une grande avancée dans la coordination et le partage des informations, des analyses et des opérations, tant au niveau stratégique que tactique. Son rôle consiste en particulier à élaborer et coordonner les stratégies nationales.
En ce qui concerne la législation, le CNI continue d’être régi principalement par : Loi organique 11/2002 du 6 mai, réglementant le Centre national de renseignement (Ley Orgánica 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia) ; Loi organique 2/2002 du 6 mai, réglementant le contrôle judiciaire préalable du Centre national de renseignement (Ley Orgánica 2/2002, de 6 de mayo, reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia). Autres textes pertinents : Décret royal 436/2002 du 10 mai établissant la structure organique du Centre national de renseignement (Real Decreto 436/2002, de 10 de mayo) ; Décret royal 593/2002 développant le régime économique et budgétaire du Centre national de renseignement (Real Decreto 593/2002) ; Décret royal 421/2004 du 12 mars réglementant le Centre cryptologique national (Real Decreto 421/2004, de 12 marzo) ; Loi 36/2015 sur la sécurité nationale (Ley 36/ 2015 de Seguridad Nacional). Reste malheureusement en vigueur l’obsolète Loi 9/1968 du 5 avril sur les secrets officiels, modifiée par la Loi 48/1978 du 7 octobre (Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre Secretos Oficiales modificada por Ley 48/1978, de 7 octubre), un texte ne prévoyant aucune déclassification automatique fondée sur l’écoulement du temps.
Vous citez Ulrich Beck, qui écrit : « Nous vivons, pensons et agissons avec des concepts anciens qui, pourtant, continuent de gouverner notre pensée et notre action (…) déjà dépassés ». Partagez-vous cette idée ? Comment les services de renseignement peuvent-ils s’adapter à un monde où les frontières entre guerre, droit pénal et renseignement deviennent floues ? (González Cussac, “Servicios de inteligencia y contraterrorismo”, 2018, p. 35, qui cite Ulrich Beck, Sobre el terrorismo y la guerra, 2003)
Je partage totalement l’idée de Beck. Elle fut également exprimée de manière magistrale par Edward Osborne Wilson dans Harvard Magazine (2009) : « Nous avons des émotions du Paléolithique, des institutions médiévales et une technologie digne d’un dieu. Et cela est terriblement dangereux. »
L’ère numérique bouleverse tout : les menaces — comme le terrorisme — autant que les réponses qui y sont apportées. Les services de renseignement, pour rester l’avant-garde de notre sécurité, doivent se transformer en profondeur et s’adapter à cette nouvelle réalité. Nos sociétés doivent aussi adapter leur législation, notamment en matière de droits fondamentaux, à l’ère numérique. C’est notre plus grand défi.
Vous expliquez que le 11 septembre 2001 a marqué une rupture : les distinctions entre sécurité intérieure et extérieure ont perdu leur sens. Comment cette transformation s’est-elle traduite, dans le cas de l’Espagne, dans la structure et la coordination entre services de renseignement, forces de police et autorités judiciaires ? (González Cussac, 2018, p. 36-44)
Il faut rappeler que l’Espagne porte un long passé de terrorisme remontant à la dictature du général Franco. Certains groupes d’extrême droite et d’extrême gauche ont également agi durant la transition démocratique (1975-1982), avant de disparaître ou de diminuer leur activité. Cependant, un secteur fanatique de la gauche nationaliste basque, soutenu par le silence du reste des forces nationalistes, a maintenu le terrorisme de l’ETA jusqu’en 2011/2018. C’est pourquoi nos services de renseignement, policiers, ainsi que notre législation et notre système judiciaire avaient développé des stratégies et des pratiques antiterroristes solides. Toutefois, les attentats du 11 mars 2004 ont provoqué un choc immense, avec 198 assassinats dans les trains de banlieue de Madrid. Cela a entraîné de nouvelles réformes législatives et la nécessité d’un renforcement de la coopération. La création en 2014 du CITCO, héritier d’un organisme fondé après les attentats de 2004, illustre clairement la transformation profonde des appareils de sécurité et de renseignement espagnols ainsi que de la législation. Le nouveau terrorisme l’exigeait. Cette adaptation nécessaire à la menace djihadiste fut similaire dans les autres pays européens et dans d’autres États occidentaux
L’Espagne est passée d’un terrorisme d’origine interne à une menace djihadiste globale. Quelles leçons institutionnelles tirez-vous de cette évolution dans la gestion du régime de renseignement antiterroriste espagnol ? (González Cussac, 2018, p. 36-38)
La réponse espagnole a sans doute été plus rapide en raison de l’expérience acquise face au terrorisme de la période précédente (la « troisième vague » selon la classification de RAPOPORT). Bien que l’adaptation au nouveau terrorisme — celui de la « quatrième vague » — ait été difficile, nous ne partions pas de zéro. Ce terrorisme se déployait dans de multiples territoires, avec d’autres temporalités, d’autres organisations, d’autres langues. Il impliquait aussi des objectifs, une échelle et des moyens d’attaque inédits, ainsi qu’un usage massif du message médiatique et de la propagande. Ces changements ont entraîné des modifications significatives des équipes, des profils d’agents et, surtout, une intensification du renseignement extérieur et partagé.
Vous mettez en garde contre la « fusion des fonctions » entre renseignement et police, qui peut affaiblir les garanties procédurales. Comment préserver la séparation fonctionnelle entre prévention et répression sans compromettre l’efficacité de la coopération entre le CNI, la Guardia Civil et la Policía Nacional ? (González Cussac, 2018, p. 46-51)
En partant d’un contrôle judiciaire pour toute activité portant atteinte aux droits fondamentaux, je pense que les services de renseignement peuvent disposer d’un cadre juridique plus flexible pour la collecte de données et d’informations, car leur objectif n’est pas de découvrir ou de poursuivre des délits, mais de produire du renseignement à partir de sources ouvertes ou fermées. Leur fonction est de réduire l’incertitude dans la prise de décision du gouvernement face aux risques, menaces et défis de sécurité nationale.
La police, en revanche, doit prévenir et poursuivre les délits selon des normes constitutionnelles et procédurales strictes, puisqu’elle vise à prouver des faits susceptibles d’entraîner une peine. La coordination doit se faire face à des phénomènes hybrides : terrorisme, crime organisé transnational, cybersécurité. Des centres de fusion de l’information doivent être mis en place. Mais selon moi, les services de renseignement devraient intervenir dans les phases les plus précoces, la police n’intervenant qu’à partir des actes préparatoires punissables. Cependant, l’efficacité et les moyens des services de renseignement semblent pousser les gouvernements à leur confier plus de fonctions qu’ils ne devraient en avoir.
Le secret est inhérent à l’activité de renseignement, mais il entre souvent en tension avec la transparence démocratique. Quels mécanismes de contrôle vous semblent adaptés pour concilier confidentialité nécessaire et respect de l’État de droit ? (González Cussac, 2018, p. 50-52)
Il faut approfondir les trois contrôles classiques : judiciaire, gouvernemental, et surtout parlementaire. Il s’agit de passer d’une reconnaissance formelle à un exercice réel. Il est également nécessaire d’avancer dans la déclassification des informations et leur accès par les chercheurs, journalistes et citoyens. Il semble aussi raisonnable de freiner la tendance actuelle à la sur-classification. Cela bénéficie également aux services eux-mêmes : leurs fonctions gagnent en légitimité, et la bureaucratie liée à la classification diminue.
Vous soulignez que la circulation d’informations entre États et services européens est l’un des défis les plus sensibles du contre-terrorisme contemporain. Faut-il avancer vers une réglementation européenne unifiée concernant la collecte, l’échange et l’utilisation du renseignement ? (González Cussac, 2018, p. 52-55)
L’article 4 du Traité sur l’Union européenne exclut la sécurité et la défense nationales des compétences européennes. Ces matières demeurent entre les mains des États membres, bien qu’elles doivent respecter le droit communautaire.
Mais si les Européens veulent préserver leur mode de vie, nous devons aller vers des politiques communes de défense et de sécurité. Cela implique au minimum d’articuler des mécanismes ou des organismes de partage du renseignement.
Des avancées importantes existent déjà : INTCEN, chargé de compiler et analyser les informations fournies par les États ; EUMS-INT, division renseignement de l'État-major de l’UE ; la SIAC, Capacité unique d’analyse de renseignement ; le SATCEN, centre satellitaire de l’UE situé en Espagne ; la European Intelligence Academy (ICE) à Paris, visant à développer une culture commune du renseignement.
La justice pénale préventive, telle que développée par le Prof. Emiliano Borja Jiménez, repose sur la détection anticipée de « signaux faibles ». Ce modèle déplace le centre de gravité du droit pénal de la culpabilité vers le risque. Où situer la limite entre prévention légitime et intrusion dans la vie privée ? L’Espagne a-t-elle trouvé un équilibre durable entre efficacité du renseignement et protection des droits fondamentaux ? (Borja Jiménez Emiliano, “Justicia penal preventiva y Derecho penal de la globalización”, 2018, p. 160-168)
Je distinguerais deux types d’activités anticipatoires portant atteinte aux droits fondamentaux :
- Celles menées exclusivement à des fins de renseignement, pouvant disposer d’un cadre plus flexible, mais toujours sous contrôle judiciaire.
- Celles menées dans le cadre de la procédure pénale, dirigées par le ministère public ou les juges, dont l’objectif est de rechercher des preuves pouvant conduire à une condamnation.
Dans ce second cas, l’anticipation vise aussi à prévenir des actes déjà amorcés, ce qui peut entraîner la privation de droits fondamentaux. La législation espagnole, surtout depuis la réforme du Code pénal de 2015, a largement avancé la ligne d’intervention pénale, enregistrant le plus grand nombre de détentions et condamnations en Europe pour des délits d’endoctrinement, propagande ou apologie du terrorisme. Un débat majeur s’est ouvert en Espagne à ce sujet. Selon moi, il faut distinguer clairement entre surveiller pour produire du renseignement, et surveiller pour punir des phases très éloignées du danger réel
El desarrollo del ciber espionaje y el uso de herramientas de análisis algorítmico abren nuevas posibilidades en la lucha contra la radicalización, pero también plantean riesgos evidentes. ¿Cómo evitar que estas tecnologías se conviertan en un instrumento de vigilancia masiva? ¿Cree usted necesario establecer una ética de la inteligencia artificial aplicada al ámbito de la seguridad? ¿Qué medidas se están debatiendo en España en este sentido? (González Cussac, 2018, p. 55-57)
Le Parlement européen a déjà produit de très intéressantes études montrant que nous n’avons pas actualisé notre système de droits fondamentaux à l’ère numérique. Nos droits politiques et procéduraux sont aujourd’hui hautement vulnérables face aux technologies, qu’elles soient utilisées par des acteurs étatiques, des entreprises ou des groupes criminels.
L’Europe fait face à un défi immense, mais reste la référence mondiale pour poser des règles. Il manque non seulement des règles éthiques, mais aussi des normes juridiques couvrant tous les aspects de ces technologies. Les Européens possèdent une tradition millénaire fondée sur les règles. Toute activité humaine peut être régulée. Dans ce défi, nous sommes relativement seuls, car les superpuissances ne partagent pas cette tradition ou ont d’autres intérêts. Cependant, les nouvelles technologies utilisées par des acteurs hostiles représentent une menace existentielle, ce qui exige aussi de développer des outils numériques pour les neutraliser. D’où l’idée de « souveraineté numérique européenne ».
La réforme pénale de 2015 a introduit des dispositions sur le terrorisme individuel et numérique. Quel a été son impact sur les services de renseignement ? A-t-elle élargi leur champ d’action vers la sphère civile ou digitale ? (Colomer Bea David, “La incriminación del terrorismo a partir de 2015”, 2015, p. 135-150)
Comme je l’ai indiqué, les services de renseignement stratégique en Espagne — le CNI — ne poursuivent pas de délits. Leur champ d’action n’a donc pas été modifié par la réforme. En revanche, elle a profondément transformé les services policiers et la procédure pénale.
Les forces de police, sous le contrôle du ministère public et des juges, ont pu anticiper leur surveillance et poursuivre des actes préparatoires ou périphériques du terrorisme. Cela a permis des détentions et condamnations pour propagande, apologie ou endoctrinement numérique.
Les services de renseignement européens présentent des niveaux de contrôle très hétérogènes. Quels éléments du modèle espagnol pourraient servir d’exemple à d’autres États membres ? (González Cussac, 2018, p. 52-55)
La Constitution espagnole de 1978 exige qu’toute interception de communication ou toute entrée dans un domicile soit préalablement autorisée par un juge (art. 18). Cela s’applique également au CNI, même s’il ne poursuit pas des délits.
Ainsi, les services de renseignement doivent obtenir une autorisation judiciaire pour intervenir des communications ou pénétrer dans un domicile. Cela offre une forte sécurité juridique aux citoyens, aux pouvoirs publics et aux agents du renseignement. Cette exigence me semble très recommandable.
En 2023, vous avez pris la direction de la Chaire « Droit des victimes et terrorisme » de l’Université de Valence. Quels en sont les objectifs scientifiques, pédagogiques et sociaux ? Et comment ce travail centré sur les victimes s’articule-t-il avec la dimension institutionnelle du renseignement et de la justice pénale ? (González Cussac, 2018, p. 54-56)
Il s’agit effectivement d’une expérience pionnière en Espagne. Trois grands objectifs guident notre action :
- Poursuivre l’étude du terrorisme, des réponses juridiques et jurisprudences, et analyser leur évolution.
- Combattre l’extrémisme, en développant la compréhension des facteurs de radicalisation et en promouvant une culture citoyenne fondée sur les valeurs démocratiques.
- Améliorer la reconnaissance et l’actualisation des droits des victimes de toutes les formes de terrorisme.
En trois ans, nous avons travaillé avec des professionnels du renseignement, de la sécurité, de l’enseignement, des services sociaux, du monde judiciaire, ainsi qu’avec des étudiants et les associations de victimes. Les résultats incluent congrès, séminaires, conférences, rapports et même un projet de loi pour moderniser les droits des victimes. Nous espérons renouveler la chaire et poursuivre ces trois axes.
Vous concluez que la « démocratisation de la fonction de renseignement » constitue le grand défi du XXIᵉ siècle. En quoi consiste-t-elle ? Quels types de réformes seraient nécessaires pour une intelligence efficace, transparente et respectueuse de l’État de droit ? (González Cussac, 2018, p. 56-57)
Selon moi, quatre grands axes doivent être renforcés :
- Un contrôle judiciaire effectif de toute activité portant atteinte aux droits fondamentaux.
- Un contrôle parlementaire élargi et renforcé, exercé régulièrement et non seulement en cas de scandale.
- Une réduction de la sur-classification et des durées de classification, ainsi qu’un accès facilité à l’information une fois déclassifiée.
- Un renforcement de la culture citoyenne du renseignement et de la sécurité, afin que la population participe aux décisions avec une meilleure compréhension de ces questions. Cette culture doit être particulièrement développée chez les responsables politiques, les médias et les universitaires.
Nous devons tous être conscients des menaces réelles qui nous entourent et des difficultés auxquelles les services de renseignement font face pour les prévenir. Ce sont des organismes indispensables qui contribuent à la prospérité, à la liberté et à la démocratie de nos sociétés, au prix de sacrifices et de conflits.
Novembre 2025
Références :
- González Cussac, José Luis, Servicios de inteligencia y contraterrorismo, en : Alonso Rimon A., Cuerda Arnau M.L. y Fernández Hernández (Dir.), Terrorismo, sistema penal y derechos fundamentales, Tirant lo Blanch, València, 2018, p. 33-61.
- Borja Jiménez, Emiliano, Justicia penal preventiva y Derecho penal de la globalización, en : Alonso Rimon A., Cuerda Arnau M.L. y Fernández Hernández (Dir.), Terrorismo, sistema penal y derechos fundamentales, Tirant lo Blanch, València, 2018, p. 159-185.
- Colomer Bea, David, La incriminación del terrorismo a partir de 2015: ¿violencia política organizada?, Revista General de Derecho Penal, 2015, p. 135-153.
- Colomer Bea, David, Legislación antiterrorista y criminalización del salafismo, Revista General de Derecho Penal, 2022, p. 749-760.