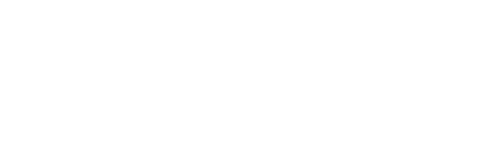Les effets secondaires de la lutte contre le terrorisme
Depuis plusieurs décennies, la lutte contre le terrorisme est une priorité mondiale. L’onde de choc des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis – suivis de ceux de Londres (2005), Paris (2015) ou Nice (2016) par exemple – a conduit à un renforcement continu des dispositifs de surveillance et de renseignement, et au glissement plus prononcé du droit pénal classique vers le droit pénal préventif. Cette dynamique s’est accélérée avec l’adoption d’instruments européens tels que la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme (CETS 196 ; 2005) et son protocole additionnel (CETS 217 ; 2015), actuellement en cours d’amendement (2023-2025), ainsi que par des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU (notamment 1373 [2001], 1535 et 1566 [2004], 2199 [2015] et 2560 [2020] ou 2617 [2021]), destinées à renforcer les politiques sur la gestion des risques et l’anticipation des menaces, ainsi que la coopération internationale.
Le « paradigme du risque et de la sécurité » (John VERVAELE, La asociación organizada terrorista y sus actos anticipativos: ¿un derecho penal y política criminal sin límites?, in: Anuario de derecho penal 2015-2016, pp. 23-42) n’est pas né au XXIᵉ siècle et s’inscrit dans une logique préventionniste apparue dès l’après-Seconde Guerre mondiale. L’expérience des procès de Nuremberg (1945–1946) a transformé la mission pénale de l’État en affirmant une logique de « défense sociale » face aux crimes les plus graves. Elle a révélé les limites d’un droit fondé sur la répression a posteriori de comportements attentatoires à des intérêts essentiels pour la société, et souligné la nécessité d’introduire des mécanismes de prévention. Des instruments tels que la Charte du Tribunal militaire international (8 août 1945) et la Control Council Law n° 10 (20 décembre 1945) ont posé les bases d’un droit pénal orienté vers la prévention des risques collectifs et une redéfinition de la responsabilité dans la commission des crimes de masse.
Portées par la logique de la « société du risque », les politiques criminelles européennes ont accéléré ce processus d’expansion du droit pénal préventif et de protection de l’ordre public (not. MENDOZA BUERGO Bianca, El derecho en la sociedad del riesgo, 2001 ; MIR PUIG Santiago & GÓMEZ Martín, La Política criminal en Europa, 2004 ; ALONSO Rimo Alberto et al., Derecho penal preventivo, orden público y seguridad ciudadana, 2019). La « justice pénale préventive » illustre cette tendance (cf. BORJA JIMÉNEZ Emiliano, Justicia penal preventiva y Derecho penal de la globalización: proyecciones en el ámbito del terrorismo, in: Alonso Rimo, Cuerda Arnau & Fernández Hernández (édit.), Terrorismo, sistema penal y derechos fundamentales, 2018, pp. 159-214). Elle renvoie aux mesures coercitives et restrictives de droits adoptées par les États pour satisfaire au sentiment d’insécurité de la société. Dans une perspective politico-criminelle, le droit pénal préventif apparaît comme une expression d’un droit pénal de la globalisation, qui tend à affaiblir les principes libéraux classiques – illicéité, culpabilité, légalité –, en restreignant les libertés fondamentales et en recourant largement à la peine au nom de la protection de la sécurité publique contre des actes transnationaux (depuis l’étranger, et dont la cible n’est pas forcément identifiée). Il prend parfois une dimension (strictement) symbolique.
Sur le plan dogmatique, le « droit pénal du risque » désigne un ensemble de normes qui incriminent des comportements situés en amont de l’infraction, parfois même antérieurs aux actes préparatoires d’une attaque terroriste ou de toute conduite créatrice d’un danger. Une telle extension du champ pénal ne fait pas consensus. Certains estiment que l’illicéité peut se fonder sur le jugement de valeur négatif de l’action (Handlungsunwert ; Disvalor de acción): le seul fait d’accomplir l’acte incriminé (décrit dans l’énoncé de fait légal) suffirait, indépendamment de son potentiel préjudiciable ou de sa capacité à créer un danger concret (not. PRITTWITZ Cornelius, Derecho penal y riesgo, 2021 ; SANCINETTI Marcelo Albero, El disvalor de acción como fundamento de una dogmática jurídico-penal racional, in: InDret 1/2017, dans une approche plus nuancée). D’autres (not. STRATENWERTH Günter, Acción y resultado en derecho penal, 1991) mettent au contraire l’accent sur le jugement de valeur négatif du résultat (Erfolgsunwert ; Disvalor de resultado), qui rattache l’illicéité du comportement à son aptitude à atteindre un intérêt essentiel ou à le mettre effectivement en danger. Selon cette dernière approche, le recours proportionné au droit pénal suppose un rapport de proximité suffisant entre le comportement réprimé et la possible survenance d’un résultat préjudiciable ou d’un danger concret.
En Suisse, le législateur aborde le terrorisme de manière très empirique, tout en adoptant les lois (ou les modifiant) en fonction de sa « perception politique et émotionnelle du terrorisme » (BIELMANN Florent & CANEPPELE Stefano, La réponse étatique au terrorisme en Suisse à partir des années 1980, in: Criminologie en Suisse: histoire, état, avenir, 2024, pp. 191-203; MOREILLON Laurent & LUBISHTANI Kastriot, Aspects choisis de l’incrimination du terrorisme, Étude de droit comparé suisse, allemand, français et anglais, in: RPS 4(136), 2018, pp. 499). Dans les années 1960, le pays a été confronté au mouvement séparatiste du Front de libération jurassien (FLJ), rapidement démantelé, tandis que sa neutralité en faisait une base logistique pour des groupes internationaux, notamment liés aux causes palestinienne et arménienne. Un tournant majeur a été « l’affaire des fiches » (1989), qui révéla une surveillance politique de grande ampleur: la police fédérale et certains services cantonaux avaient fiché environ 900’000 personnes et organisations (syndicats, partis, associations, collectifs), en majorité des militants de gauche, des syndicalistes, des pacifistes, des féministes, mais aussi des étrangers considérés comme « suspects ». L’affaire conduisit à la séparation des compétences de la police judiciaire de celles du renseignement, désormais encadrées par la Loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) de 1997 et la Loi fédérale sur le renseignement de 2015 (LRens). L’entrée en vigueur de la Loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT) en 2021 a instauré une surveillance policière des personnes à risque et autorisé des mesures administratives (à caractère pénal) hors procédure pénale, telles que l’assignation à résidence, l’interdiction de contact ou l’obligation de se présenter régulièrement aux autorités.
Sur le plan pénal, la Suisse n’a introduit une définition du terrorisme qu’en 2003 avec l’adoption de l’article 260quinquies CP sur le financement du terrorisme: « un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque ». La modification de 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469) a élargi l’arsenal avec les articles 260ter (Organisation terroriste) et 260sexies (recrutement, formation et voyage en vue d’un acte terroriste), tandis que la Loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « État islamique », et les groupes apparentés (RO 2018 335) a été abrogée et intégrée à l’article 74 LRens.
En Espagne, la lutte contre le terrorisme s’est développée en deux temps: d’abord face aux violences de l’ETA et du GRAPO, puis avec la montée du djihadisme, notamment lors des attentats de Madrid en 2004. Jusqu’à la réforme de 2015, le droit espagnol liait étroitement le terrorisme à l’existence d’une organisation structurée, hiérarchisée et dotée d’un projet politique. Le Code pénal de 1995 reflétait cette conception: ses articles 571 et suivants incriminaient principalement les actes commis au service, en collaboration avec ou en tant que membre d’organisations terroristes, alors que l’article 577 CP, qui visait des individus isolés, était interprété à travers le prisme de l’appartenance ou de la collaboration avec une organisation (COLOMER David, Legislación antiterrorista y criminalización del salafismo, 2022, en: Fernández Cabrera Marta & Fernández Díaz Carmen Rocío (édit.), Retos del estado de derecho en materia de inmigración y terrorismo, pp. 749-764).
La Loi organique 2/2015 a marqué une rupture. L’article 573 CP définit désormais le terrorisme non plus par l’appartenance à un groupe, mais uniquement par la finalité poursuivie: porter atteinte à l’ordre constitutionnel, compromettre gravement la paix publique ou semer la terreur. Cette redéfinition a consacré la figure du terrorisme individuel et rendu possible l’incrimination des « loups solitaires » agissant sans rattachement organisationnel (COLOMER David, El tratamiento penal de los desórdenes públicos, 2021, pp. 289-290). Comme le souligne l’auteur (Legislación antiterrorista, pp. 756-757), la suppression de l’élément organisationnel ou structurel a altéré la nature exceptionnelle des infractions de terrorisme et a entraîné un glissement vers un droit pénal de l’auteur, où l’on se concentre sur l’intention de mener un projet ou de s’affilier à un groupement terroriste plutôt que sur les actes.
Parallèlement, les services de renseignement ont vu leur rôle considérablement renforcé dans la lutte antiterroriste. Le terrorisme est désormais appréhendé non plus seulement comme une infraction pénale, mais comme une véritable menace à la sécurité nationale, ce qui justifie une implication croissante des services d’intelligence aux côtés de la police et des forces armées. Cette évolution a entraîné une porosité croissante entre fonctions policières et de renseignement, au risque de brouiller la distinction fondamentale entre compétences judiciaires et administratives (cf. GONZÁLEZ CUSSAC José L., Servicios de inteligencia y contraterrorismo, in: Alonso Rimo, Cuerda Arnau & Fernández Hernández (édit.), Terrorismo, sistema penal y derechos fundamentales, 2018, pp. 35-61). La nécessité de préserver la sécurité publique tend à éroder les garanties de l’État de droit, alors que la valeur et la légitimité des services de renseignement dépend à long terme de leur stricte soumission au contrôle démocratique et au respect des droits fondamentaux.
En Amérique latine, la lutte antiterroriste s’inscrit dans un double héritage: celui des régimes autoritaires du XXᵉ siècle, qui ont instauré des législations d’exception pour réprimer la « subversion » via la doctrine de sécurité nationale (notamment opérée par les forces armées et les services de renseignement), et celui de la coopération régionale post-11 septembre face au djihadisme. Plusieurs pays ont adopté ou adapté des cadres législatifs alignés sur les standards internationaux — ciblant des délits tels que le financement du terrorisme, l’adhésion à des organisations interdites ou la propagande en ligne. Toutefois, l’importation de ces normes dans des contextes déjà marqués par la violence politique et la criminalité organisée a brouillé la frontière entre la lutte contre le terrorisme et le maintien de l’ordre (DIAMI Rut , Security Challenges in Latin America, in: Bulletin of Latin American Research 23(1), 2004, pp.43-62; ARIMATEÍA DA CRUZ José, A Review of Latin American Soldiers, The Role of the Military in Latin America, 2020).
Dans ce contexte hybride, la mondialisation de la « guerre contre le terrorisme » a contribué à renforcer la légitimité du pouvoir militaire et a conduit certaines autorités à invoquer abusivement la légitime défense pour justifier des atteintes graves aux droits humains — détentions secrètes, torture ou exécutions extrajudiciaires (MEIER Markus-Michael, Enter 9/11: Latin America and the Global War on Terror, in: Journal of Latin American Studies, 2020/52, pp. 545–573).
La logique du « droit pénal de l’ennemi » (JAKOBS Günther & CANCIO MELIÁ, Derecho penal del enemigo, 2003; CANCIO MELIÁ Manuel & GÓMEZ-JARA DÍEZ Carlos (édit.), Derecho penal del enemigo, El discurso penal de la exclusión, Vol. 2, 2006) – qui vise des individus en fonction de leur dangerosité présumée plutôt que pour des actes effectivement commis – tend à se banaliser, au risque d’installer un état d’exception permanent. Or, comme l’avait déjà souligné Jaspers, il importe de distinguer la faute criminelle, de la faute politique, morale et métaphysique qui illustrent les sentiments de culpabilité d’une société et de ses membres face à des évènements traumatiques: leur confusion brouille le sens même de la responsabilité pénale et conduit à une extension illégitime du champ répressif (BROSSAT Alain, Karl Jasper, la faute et la responsabilité, in: Cahier critiques de philosophie 2014/1, n°13, p. 7-12).
Ces glissements normatifs ne sont pas sans conséquences: ils produisent certains effets secondaires que ce numéro explore, en mettant en lumière les contradictions des politiques criminelles, leurs dérives et leurs répercussions sociales.
Sophie CHAMBORDON s’intéresse aux effets secondaires relatifs au refus persistant de la Suisse de rapatrier plusieurs de ses citoyens — dont des enfants — détenus depuis 2019 dans des camps du nord-est de la Syrie, dans des conditions humanitaires critiques et sans accès à une procédure judiciaire. Cette position met en lumière une contradiction centrale: alors que la Suisse revendique, comme d’autres États, une compétence universelle pour juger les crimes terroristes les plus graves, elle refuse de l’exercer lorsqu’il s’agit de ses propres ressortissants, en invoquant des impératifs sécuritaires. L’auteure interroge la compatibilité de cette politique avec les engagements internationaux de la Confédération en matière de droits fondamentaux, de protection consulaire et de droits de l’enfant, et examine les implications de ce refus pour la responsabilité internationale de la Suisse. Elle propose enfin des pistes de réflexion sur les mécanismes envisageables pour juger les ressortissants soupçonnés d’avoir rejoint l’État islamique, à la lumière du principe de lutte contre l’impunité.
Robin KJELSSON aborde les effets de la lutte antiterroriste sur l’administration de la preuve, en se concentrant sur les enquêtes liées à la propagande terroriste. L’auteur analyse, dans une perspective pratique, les enjeux de la recherche, de la saisie et de la conservation des preuves numériques dans le cadre d’une procédure pénale. Il examine d’abord les considérations procédurales issues du Code de procédure pénale suisse, qui encadrent l’action de la police avant et durant l’enquête. S’appuyant sur son expérience de gendarme à la police cantonale neuchâteloise, ainsi que sur des entretiens avec des spécialistes et des directives internes, il consacre la partie centrale de sa contribution aux aspects techniques de la collecte et du traitement de ces preuves.
Sebastian G. CRUZ VARGAS s’interroge sur les dilemmes juridiques et éthiques auxquels le droit pénal péruvien est confronté dans des situations limites, notamment lorsque la torture est présentée comme l’unique moyen d’éviter un dommage imminent à des biens juridiques fondamentaux. L’étude s’appuie sur le contexte péruvien de lutte contre le terrorisme et l’insécurité, où ce recours apparaît comme une pratique fréquente mais disproportionnée. L’auteur mène ensuite un examen des causes de justification et d’excuse, en confrontant leurs limites normatives au droit international et au droit péruvien. Cette réflexion critique vise à éclairer la complexité de la qualification pénale (et éthique) de la torture dans des contextes extrêmes.
Ahmed AJIL revient sur la condamnation des dirigeants du Conseil Central Islamique Suisse pour violation de l’ancien article 2, alinéa 1, de la Loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « État islamique ». En produisant et diffusant une interview avec le chef spirituel de Jaysh al-Fath ainsi qu’un documentaire, ils avaient sciemment relayé de la propagande en faveur d’Al-Qaïda. L’affaire illustre le glissement vers un droit pénal préventif (ou droit pénal de l’auteur), où l’interprétation de l’intention est au cœur du système répressif.
Enfin, Cécile FORNEROD aborde les principales problématiques liées au champ d’application des normes pénales suisses dans le cadre de la lutte contre le terrorisme transnational. Elle explique les critères de rattachement à la Suisse, ainsi que les débats doctrinaux et jurisprudentiels.